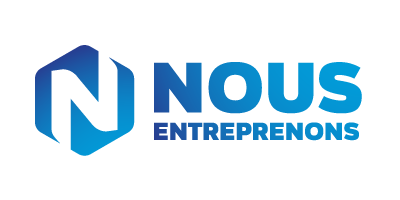Un État étranger assigné devant un tribunal français peut invoquer l’immunité pour échapper à toute poursuite, sauf exceptions strictement encadrées. La Cour de cassation a récemment confirmé que cette règle subsiste même en présence d’accords internationaux non équivoques.
Les juridictions françaises distinguent avec rigueur les actes de souveraineté et les actes relevant de la gestion privée, une frontière dont la détermination continue d’alimenter la jurisprudence. Les évolutions récentes du droit international et les divergences d’application entre pays interrogent la portée réelle de cette protection.
Comprendre l’immunité de juridiction des États : origines et fondements
Derrière la notion d’immunité de juridiction se dresse le principe selon lequel un État n’a pas à répondre devant la justice d’un autre, sans y avoir consenti. Historiquement, ce socle a été forgé par la coutume puis renforcé par de grands textes, à l’image de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, instrument adopté il y a vingt ans, mais dont l’application universelle tarde à se concrétiser.
Pour de longues années, la doctrine de l’immunité absolue régnait : impossible d’attraire un État devant les tribunaux étrangers, quel que soit l’objet du litige. L’accroissement des échanges économiques a bousculé ce schéma. Sous l’influence de la Commission du droit international, une distinction s’est imposée, redéfinissant les contours de cette immunité :
- Acta jure imperii : les actes relevant de la souveraineté proprement dite, bénéficiant d’une immunité préservée ;
- Acta jure gestionis : actes relevant de la gestion, le plus souvent des actes ordinaires ou commerciaux, progressivement exclus de la protection, principalement dans les systèmes juridiques modernes.
La démarcation est devenue centrale et s’articule autour des deux catégories suivantes :
Cette révolution a été avalisée par la Cour internationale de Justice : l’immunité n’est plus générale, elle devient « relative », soumise à l’examen précis de chaque dossier. Pourtant, la délimitation reste problématique et source de débats, les juges devant confronter cas par cas la nature de chaque acte litigieux. Chaque nouvel arrêt, chaque adaptation législative vient complexifier davantage cette frontière déjà poreuse, témoignant que la question demeure vivement disputée.
Quels principes encadrent l’immunité de juridiction en droit français ?
En France, l’immunité de juridiction se traduit par une règle nette : un État étranger ne peut être poursuivi devant un tribunal français pour des activités exerçant la puissance publique. Ce principe garantit l’égalité souveraine et la réciprocité entre États, mais la réalité judiciaire exige une analyse plus fine, notamment avec le recours désormais classique à la distinction acta jure imperii / acta jure gestionis.
La pratique des juridictions françaises, portée par la Cour de cassation et le Conseil d’État, reste fidèle à cette approche : seuls les actes strictement attachés à la souveraineté bénéficient d’une inviolabilité totale, décisions politiques, opérations diplomatiques, sécurité nationale. Pour le reste, les actes de gestion, en particulier commerciaux ou touchant à l’emploi local, ouvrent la voie à la contestation. Prenons un exemple fréquent : lorsqu’une ambassade recrute directement un salarié, ce dernier peut, dans bien des cas, saisir le juge français et contourner l’immunité de l’État employeur si le litige porte sur le contrat de travail ou le licenciement. Cette ligne de partage contraint donc le juge à une étude de fond à chaque étape.
Progressivement, des exceptions se sont imposées, autorisant l’action du juge français pour des dommages causés sur le territoire ou dans des contentieux relevant de la vie locale. Ces assouplissements, inspirés des standards internationaux, s’appliquent bien que la Convention des Nations Unies de 2004 n’ait toujours pas d’effet contraignant à ce jour. C’est donc sur la base du droit international privé et de l’interprétation constante du Code de procédure civile que le droit français affine la portée de l’immunité. L’enjeu ? Trouver le juste équilibre entre la préservation de la souveraineté et l’accès à une forme de justice, y compris pour les personnes confrontées à l’action d’un État étranger.
États-Unis vs France : différences notables dans l’application de l’immunité
Mettre face à face la France et les États-Unis sur le terrain de l’immunité de juridiction révèle des visions tranchées. Outre-Atlantique, le Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de 1976 a figé un encadrement solide : un texte législatif qui fixe clairement les cas de protection, les dérogations et la compétence du juge. Tant que la loi fédérale n’identifie pas d’exception, l’État étranger garde sa protection devant la justice américaine. Mais à la moindre brèche, contrat commercial, dommage sur le sol national, affaires touchant au terrorisme, le plaignant peut se tourner vers le juge fédéral, fort d’un cadre statutaire exhaustif.
En France, la démarche reste largement jurisprudentielle et ancrée dans le droit international coutumier. La distinction clé entre actes de souveraineté et actes de gestion se construit au fil des arrêts, sans viser l’exhaustivité des textes américains. Les juges veillent à préserver la prérogative étatique et n’acceptent d’entendre un litige que lorsque le lien local et la qualification de l’acte sont nets, emplois localisés, préjudices subis sur le sol français.
Pour mieux saisir ce jeu de miroirs, voici les différences majeures qui découlent de ces deux systèmes :
| Critère | États-Unis | France |
|---|---|---|
| Source du droit | FSIA, loi fédérale | Jurisprudence, droit international |
| Exceptions notables | Actes commerciaux, terrorisme, dommages corporels | Actes de gestion, litiges locaux limités |
Le système américain favorise la responsabilité étatique et l’ouverture des prétoires, tandis que la France défend vigoureusement la souveraineté, quitte à réduire l’accès des plaignants à la justice. Ce contraste incarne la tension entre protection des États et accès au recours, une ligne de crête qui habite le droit international contemporain.
Ressources et pistes pour approfondir la question de l’immunité étatique
Afin d’aller plus loin sur la question de l’immunité de juridiction, certains textes et outils de référence s’imposent. La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens permet d’appréhender les grands choix opérés par la communauté internationale, en posant les bases du droit international coutumier et du régime de l’immunité.
Pour engranger un regard doctrinal ou comparatif, les principaux traités publiés sous l’égide de maisons comme Dalloz ou LGDJ constituent des ressources solides, en particulier lorsqu’il s’agit de décrypter la frontière mouvante entre acta jure imperii et acta jure gestionis. Les revues spécialisées, notamment la Revue critique de droit international privé, interrogent l’évolution de la jurisprudence française, croisent les regards avec la pratique du monde anglo-saxon, et reviennent, affaire après affaire, sur les hésitations du juge.
La jurisprudence, en France comme à l’étranger, reste un laboratoire précieux pour suivre le tracé de cette règle. L’analyse des arrêts de la Cour de cassation ou des décisions de la Cour internationale de Justice, sans oublier les avis de la plus haute juridiction italienne, enrichit la vision comparative et alimente le débat.
Voici les principales ressources à consulter pour qui souhaite étudier plus avant cette notion mouvante :
- Les rapports et synthèses produits par la Commission du droit international des Nations Unies, qui proposent une vue d’ensemble sur les défis actuels pour la pratique.
- Les études publiées par certaines organisations internationales, dont le Conseil de l’Europe, qui examinent la question des privilèges et immunités des agences et institutions publiques à l’échelle continentale.
Ces supports permettent d’obtenir une compréhension affûtée et actuelle du sujet :
L’immunité de juridiction dessine une frontière toujours mouvante entre puissance publique intouchable et responsabilité devant le juge. Chaque dossier, chaque actualité réinterroge cette ligne rouge, et nul ne peut prédire à quel point elle résistera aux évolutions du droit international.